En zone rurale, c'est la « double peine »

Dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, qui a lieu le 25 novembre, Manon Meunier, la députée de la 3e circonscription de la Haute-Vienne, va déposer une proposition de loi de lutte contre les violences conjugales dans les territoires ruraux.
C'est un calcul mathématique pourtant simple : seulement 33 % de la population française vit en milieu rural où se concentrent 47 % des féminicides...
Interconnaissance
À la campagne, « tout le monde se connaît ». Aussi, on constate une plus grande difficulté des femmes victimes de violences à témoigner par crainte de représailles, le moindre déplacement étant visible et donc l'anonymat n'étant pas garanti. Quand l'auteur est connu de tous et potentiellement apprécié, il est toujours plus difficile de trouver un interlocuteur/trice qui accueille la parole de la victime sans jugement ni préjugé. La Fédération nationale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles (FNCIDFF) a réalisé une grande enquête auprès des Centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) présents en zone rurale. Près de 20 % citent le manque d'anonymat et 13 % l'absence d'espaces de confidentialité comme premier obstacle à l'identification des femmes victimes de violences conjugales.
Isolement géographique
L'isolement géographique implique un éloignement des structures d'assistance et de prise en charge, renforcé par la disparition des services publics de proximité dans de nombreuses zones rurales. La désertification médicale (le médecin traitant est souvent le premier point de chute pour les victimes) qui touche tant les campagnes, vient encore aggraver l'isolement des femmes qui vivent dans ces territoires.
De plus, la question de la mobilité est essentielle. Alors que 80 % des déplacements dans les territoires ruraux s'effectuent en voiture, une femme sur cinq ne dispose pas du permis de conduire. Et celles qui l'ont n'ont parfois pas de véhicule personnel ou alors ce dernier fait l'objet d'une surveillance accrue (GPS, relevé kilométrique...).
Précarité économique
La vulnérabilité des femmes victimes de violences conjugales en milieu rural est accentuée par des facteurs d'ordre économique. En effet, les femmes sont, de manière générale, davantage concernées par le chômage et la précarité économique. Cela est d'autant plus vrai dans les territoires ruraux, où 21 % des femmes salariées ont un contrat précaire contre 13 % dans les communes les plus urbaines. En outre, dans les territoires ruraux, on note un différentiel du taux de chômage plus important entre les femmes et les hommes (+ 1,8 à 1,9 point).
3919
En 2018 sur l'ensemble des appels sur la ligne dédiée au 3919, le numéro national de référence pour l'écoute et l'orientation des femmes victimes de violences et en particulier de violences conjugales, on comptabilisait 26 % d'appels provenant d'une région classée comme principalement rurale, traduisant une méconnaissance de ces dispositifs par les femmes issues de ces territoires.
Armes à feu
Entre 2018 et 2022, sur les 606 féminicides conjugaux perpétrés en France, on dénombre 168 féminicides par arme à feu, soit près de 28 %, dont plus de la moitié a eu lieu dans un territoire rural. Si l'on s'intéresse au profil des femmes victimes de féminicides au moyen d'une arme à feu, on remarque que les femmes âgées représentent une part conséquente, plus de la moitié a en effet plus de 60 ans. Les armes à feu sont plus importantes dans les territoires ruraux, du fait de la pratique de la chasse par exemple, avec parfois des armes non répertoriées qui sont le fruit d'un héritage familial.
Projet de loi
Relevant des « zones d'ombre » dans le plan « France Ruralités » présenté en juin 2023 par Elisabeth Borne, alors Première ministre, Manon Meunier a souhaité élaborer un projet de loi de lutte contre les violences conjugales dans les territoires ruraux après avoir mené une quinzaine d'ateliers (près de 200 personnes y ont pris part) sur sa circonscription du nord Haute-Vienne en conviant les associations et des acteurs de terrain. Un colloque a aussi eu lieu, auquel a participé l'association des maires ruraux de France, qui s'est emparée de cette problématique. En Haute-Vienne, l'AMRF a commencé à développer le dispositif ERRE (Élus Ruraux Relais de l'Égalité) afin de former et d'accompagner les élus pour détecter, prévenir et agir face aux violences et discriminations en milieu rural.
Qu'est-il ressorti de tous ces échanges ? « Il est nécessaire d'améliorer le maillage des hébergements d'urgence pour les femmes en milieu rural, de permettre aux services publics de répondre davantage à l'accueil de la parole, de mettre en œuvre des dispositifs afin que les victimes sachent où demander ''discrètement'' de l'aide ainsi que des taxis pour avoir accès à des personnes/services pour les accompagner, le manque de mobilité étant un frein », énumère sommairement la parlementaire, qui espère pouvoir déposer sa proposition de loi dans les semaines à venir.
Celle-ci se compose de 5 chapitres : renforcer la prévention ; accroître le réseau d'acteurs susceptibles de détecter les situations de violences conjugales et d'accompagner les victimes ; rendre chacun acteur et actrice de la lutte contre les violences conjugales en milieu rural ; améliorer l'accès aux droits : par une meilleure information et des dispositifs « aller-vers » ; améliorer la prise en charge et l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales.
Quant aux solutions pour qu'il n'y ait plus de trous dans la raquette ? La députée est claire : « Tout est une question budgétaire. Les hébergements d'urgence pour mettre à l'abri les femmes et les enfants nécessitent de la part de l'État de mettre en place des moyens. Il est, également, primordial de densifier le maillage des services publics en zone rurale et d'arrêter de supprimer tous les accueils humains au profit du numérique ».







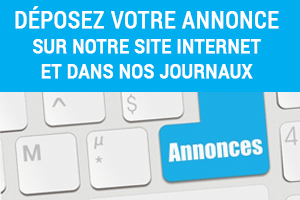






0 commentaires